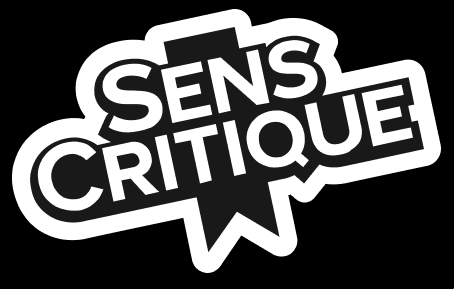À l’écran, plusieurs images de visages se superposent, décalées et mouvantes, créant une saisissante distorsion de ceux-ci comme pour y révéler le monstrueux qui est en nous. Mais d’où vient-il, ce monstrueux ? Quel est-il ? Quelles en sont les racines profondes ? La guerre peut-être (ces gueules cassées à la Bacon que l’on exhibe dans les cirques). La misère sans doute. Et une société d’après-guerre sans pitié, sans sentiment, sans empathie pour personne et surtout pas pour les femmes… Nous sommes à Copenhague, en 1919. Karoline, ouvrière dans le textile, lutte pour survivre dans un monde comme aux bords des ténèbres. Enceinte de son patron qui, contre son gré, la rejettera, Karoline, en tentant d’avorter, va rencontrer Dagmar Overbye. Sous ses airs protecteurs, Dagmar cache un sinistre, un monstrueux secret…
Et quoi de mieux, pour illustrer le monstrueux, que d’adopter la forme du conte (il y a aussi comme un soupçon de Zola là-dedans) ? Un conte noir (et en noir et blanc) dont aucun archétype ne saurait manquer… Il y a donc une jeune femme vivant dans un grenier insalubre, un prince charmant pas si charmant que ça, un «monstre» au cœur pur, une petite fille étrange et une marchande de bonbons qui se révèlera figure du Mal absolu, camouflée derrière celle de la Bonne Samaritaine prodiguant entraide et sororité. Car Dagmar Overbye est une tueuse. Une tueuse en série qui, entre 1913 et 1920, assassina vingt-cinq enfants, principalement des bébés non désirés, abandonnés à elle par des femmes ne sachant pas comment, dans une société puritaine faisant peu cas de leur situation (pauvreté, honte, rejet, viol…), les assumer et les élever.
Magnus von Horn entremêle sombre fiction et réalité macabre pour livrer une œuvre cruelle et horrifique sur les bas-fonds de la condition humaine, et Karoline, qui sans cesse les côtoie et les éprouve (et à qui rien n’est épargné), en sera notre guide. Et von Horn de ne guère nous laisser le choix : il faut, en effet, pouvoir accepter l’aspect un rien outré de son film, dans le fond comme dans la forme (ambiance sonore amplifiée, musique dissonante et scènes étranges qui, parfois, font penser à Lynch, en particulier Eraserhead et Elephant man), pour arriver à s’imprégner de sa sombre beauté (et pour peu que l’on y goûte, évidemment).
Car à force d’excès et de froide stylisation, on finit par ne plus ressentir grand-chose, quand bien même on aurait commencé à ressentir quelque chose (émotions, stupeurs, tremblements, autre chose peut-être), sinon une certaine lassitude face à ce déroulement, ce déchaînement même, d’horreurs et de noirceur arty. Pourtant von Horn, quand il veut, sait faire dans le sobre et le touchant, par exemple quand il filme un simple reflet de miroir dans lequel Karoline et son mari au visage mutilé se mirent, l’un à côté de l’autre, presque enlacés, leurs mains se frôlant doucement dans un temps comme suspendu. Comme extérieur, pour quelques secondes, aux infamies de leur existence.
Article sur SEUIL CRITIQUE(S)