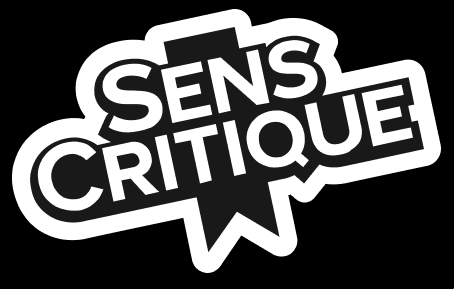Ryūnosuke AKUTAGAWA (1892-1927) est connu pour l’écriture de 150 nouvelles, souvent inspirées de contes anciens japonais. Cette édition française (1965), traduite par MORI Arimasa (1911-1976), universitaire japonais francophone, et préfacée par l’écrivain français Claude ROY (1915-1997), comprend 15 contes (écrits entre 1915 et 1927, soit entre 19 et 35 ans) dont le plus connu, Rashōmon [car adapté au cinéma mais dont le film éponyme d’Akira Kurosawa (1910-1998) s’inspire aussi d'une autre nouvelle, « Dans le fourré »] donne son titre au recueil. Les nouvelles, bien qu’elles reflètent probablement l’état d’esprit de l’écrivain (éiste, mélancolique, épris de perfection), sont de qualité inégale. La meilleure est, bien sûr, « Dans le fourré » (1921), rendue célèbre par le cinéaste Akira Kurosawa : belle démonstration sur l’absence de vérité absolue, toujours relative, avec les récits par 3 personnages (un brigand Tajōmaru, Takehiro et sa femme Masago), de la mort de l’un d’eux (Takehiro). « Le martyr » (1918) est émouvant : Lorenzo, orphelin accusé injustement de paternité, fait preuve d’un comportement exemplaire. « Chasteté d’Otoni » (1922) est très bien écrit, notamment l’ambiance dans la maison vide avec le chat et la fin, douce-amère. « Le fil d’araignée » (1918) est un conte fantastique sur l’égoïsme d’un malfaiteur meurtrier, un peu dans l’esprit des « Fables » de La Fontaine, avec une araignée. « Figures infernales » (1918) est un conte cruel : faut-il tout sacrifier à l’art ? « Le nez » (1916) qui raconte les soufs du grand aumônier Zenchi vis-à-vis de son long nez mais dont le raccourcissement ne le rend pas plus heureux, est à rapprocher du « Gruau d’ignames » (1916), parabole sur un fantasme qui disparait au fur et à mesure qu’il va se réaliser. « Les vieux jours du vénérable Susanoo » (1920) est un conte où l’amour (d’Ashihara Shikoo pour Si) est plus fort que la méchanceté de son futur beau-père, Susanoo, divinité expulsée du ciel à cause de sa sauvagerie. On retrouve l’intérêt de l’écrivain japonais pour les chrétiens avec « Le rapport d’Ogata Ryōsai » (1916), récit froid comme un rapport médical, sur un médecin qui refuse de soigner Sato si sa mère ne renie pas sa foi chrétienne, et « Ogin » (1922), dont le titre est le nom d’une orpheline qui préfère abjurer sa foi chrétienne pour retrouver ses parents, bouddhistes, en enfer. « L’illumination créatrice » (1917) est une nouvelle, certainement, autobiographique, qui retranscrit les affres de la création de l’écrivain (60 ans), Takizawa Sakichi dit Bakin (1767-1848) dont le chef d’œuvre est « Hakkenden » (1841) ou « Histoire des huit chiens-guerriers », en 96 volumes (sic), doutant de son talent, prêt à réécrire les dernières pages de son chef d’œuvre et ressentant un sentiment de solitude. Classique, sans plus. « Le mouchoir » (1916) traduit l’intérêt de l’écrivain japonais pour ses confrères européens, le Norvégien Henrik Ibsen (1828-1906) et le Suédois August Strindberg (1849-1912). Dommage qu’il n’y ait pas vraiment de chute. Les 2 nouvelles les plus ennuyeuses sont « Villa Genkaku » (1927) sur une villa où habitent beaucoup de personnages, parents et serviteurs, petit monde mesquin sans intérêt, et « Les Kappa » (1917) où le narrateur, patient d’une clinique psychiatrique, découvre, à l’occasion d’une randonnée dans les Alpes japonaises, le monde des Kappa, animaux imaginaires, batraciens à l’aspect d’enfant, aux mains et pieds palmés. Cela se veut une satire sociale mais plate et ennuyeuse, loin des « Lettres persanes » (1721) de Montesquieu (1689-1755).