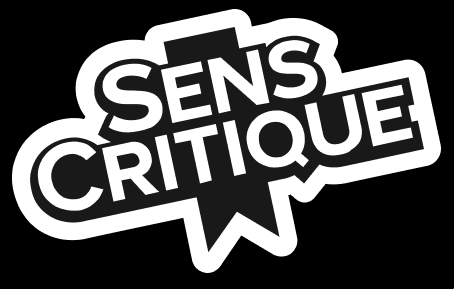La sortie du dernier film en date d’Alex Garland, Civil War, fut accompagnée par une polémique assez intéressante. Dans ce film traitant d’une guerre civile déchirant les États-Unis, on reprochait au réalisateur de ne pas suffisamment exposer les motivations de chaque camp, et surtout leur bord politique. Pas de parti pris, pas de posture, et donc, selon une partie du public ou de la critique, un film qui n’avait rien à raconter, sinon à montrer des scènes de violence chaotique – ce qui se révélait être précisément son sujet, puisque le récit suivait un groupe de reporters de guerre documentant par l’image cette apocalypse. Le cinéaste assume au point de reproduire la même approche dans son prochain film Warfare, consacré à un peloton de Navy Seals durant la guerre en Irak.
Ne pas se positionner : voilà bien un point que l’époque, tout en avis tranchés et en idéologies radicales, ne peut accepter. Voilà ce que fait Albert Serra, dans son premier documentaire consacré à un torero, Andrés Roca Rey, dont il va suivre le moindre mouvement. Pas de voix off, pas d’interview, pas de contexte, mais un imposant dispositif technique (tournage à quatre caméras simultanées, micro-cravate sur tous les intervenants) et un total de 600 heures de rushes duquel surgit cet audacieux ballet mortuaire.
Si Tardes de soledad ne formule pas un avis, il brandit pourtant une impressionnante série de choix en termes de mise en scène. Le cadrage, resserré sur son protagoniste, oblitère volontairement tout ce qui l’entoure, dans une vision étouffante qui restitue le duel avec la bête. Aucun plan d’ensemble ne donnera à voir l’arène, et nous n’aurons du public que la clameur accompagnant les mouvements ou les audaces du torero. La fascination du cinéaste est évidente : pour la précision des gestes, pour la chorégraphie qui se dessine, et qui vire presque à l’abstraction tant elle finit par se répéter, jusqu’à une forme de nausée hypnotique. Mais le taureau bénéficie de la même acuité : la bête, qui ouvre le film dans un territoire qui lui appartient, sans les hommes, et regarde longuement l’objectif, instaure un défi moral avec le spectateur, qui devra se confronter à sa souf et un rituel truqué d’avance, organisé autour de sa mise à mort.
J’ignore si les partisans de la corrida y verront un hommage à cette pratique, permise par des prises de vues inédite et une valorisation du talent hors pair d’un torero qui, malgré la violence de certains accrochages, retourne toujours finir le combat. Ce qui est certain, c’est que les défenseurs de la cause animale qui oseront se confronter à ce regard frontal ne pourront que confirmer l’indignation face à cette pratique barbare.
Car si Serra ne prend pas parti, son silence et la nudité de son observation produit forcément du discours. Les séquences en dehors de l’arène lèvent ainsi le voile sur le culte de l’ego du torero, entouré d’une cour ne cessant de le valoriser, le tout dans une ambiance viriliste caricaturale, où le terme « couille » semble être l’argument ultime sur ce qu’on doit afficher et prouver face à la foule. Les insultes à l’animal (régulièrement traité de « fils de pute »), l’attention portée à l’habit (fantastique scène où l’être androgyne est enfilé comme un objet dans son costume) et l’attitude même de la star, cambrée vers la foule construisent un portrait particulièrement ambivalent, où l’outrance, condition même du spectacle, peut à tout moment basculer vers le grotesque.
On retrouve ici le cœur du cinéma de Serra, toujours avide de traquer, au sein d’une comédie humaine particulièrement ostentatoire (qu’on se souvienne des forfanteries mondaines de son Haut-Comissaire de la République à Tahiti dans Pacifiction), les soubassements du vide. Dans cette valse morbide se jouent certes des vérités profondes sur le danger, l’esthétique du geste ou la mise en scène de la mort. Mais tout ceci est aussi, avant tout, un spectacle, dont on ne peut s’empêcher de questionner la légitimité morale. Le fait que Serra refuse de montrer le public est peut-être un prolongement de cette interrogation, de même que ces très longues séquences dans le van, où le torero, à nu, est forcé de laisser la lumière de la caméra allumée sur son visage ; contraint d’accepter un plan fixe, miroir implacable auquel il n’a rien à dire.