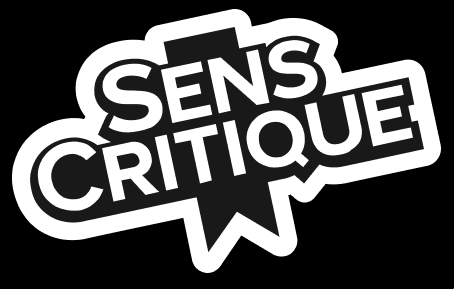Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé, premier long métrage de Bogdan Mureşanu, est une incroyable comédie, qui suscite le rire ou le sourire en montrant l’incongruité des situations que vivent les personnages. Sauf que cette incongruité tient à ce qu’il y a de tragique en elles, toute dictature imposant sa terreur par de grandes ou de menues exigences ubuesques. Une tragicomédie, donc, sachant qu’une tragicomédie reste une comédie, comme le dit sentencieusement un metteur en scène de théâtre dans le film.
Le film rend un hommage sensible à des êtres fictifs (tous remarquablement interprétés) mais qui incarnent de toute évidence des destins réels. Car il est question de comique de situation et non de comique de caractère, et les personnages ne sont jamais moqués, au contraire : ils sont exaltés dans leurs tentatives de faire avec ou contre (selon leurs possibilités) la dictature sanglante des Ceausescu et sa tentaculaire emprise sur la cité tout entière.
Pour montrer la variété des formes que prend cette emprise, le film se construit par le croisement de six récits qui racontent comment une dictature s’imprègne dans les âmes et dans les corps : et si l’on ne voit pas les âmes, les corps parlent, d’autant mieux qu’ils sont filmés de près, avec de nombreux gros plans sur les visages ou sur des gestes ténus qui trahissent l’angoisse, le désespoir, la lassitude ; d’autant mieux que le choix fréquent d’une caméra à l’épaule nous donne à voir le tremblé du réel, saisi comme à la volée, nous mettant ainsi au cœur des situations.
Une des conséquences de ce choix esthétique est sa portée éthique : en nous montrant des situations banales et en nous y intégrant, le film nous donne à penser que ce que nous voyons n’est pas totalement étranger à ce que nous connaissons dans nos propres vies ; car ce qu’une dictature sait instaurer de peur et de soumission à grande échelle et dans une brutalité sans pareil, d’autres pouvoirs le font plus discrètement ou plus insidieusement : il me semble difficile pour le spectateur de ce film de ne pas penser, à voir ces personnages de tous les jours, à ceux que l’on croise quotidiennement et dont la crainte d’une arrestation ou la fatigue d’une précarité se lit dans les yeux.
Mieux encore : le film évoque ou montre (de façon trop systématique pour que ce soit le fruit du hasard et non d’une intention concertée) des violences domestiques – sur un enfant, une mère, une femme, une maitresse –, dont certaines peuvent, aux yeux de leurs auteurs, se légitimer de la dictature qu’ils servent ou qu’ils subissent, d’autres étant tout simplement le fait du pouvoir du plus fort. Et je me suis dit vers la fin du film que sa portée éthique résidait dans la démonstration que l’incorporation de la terreur organisée par une dictature aussi planifiée que celle de la Roumanie d’avant 1989 se nourrit de ces terreurs ordinaires que des vies ordinaires subissent ou font subir.
Autant dire que l’objectif de Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé n’est pas de faire l’histoire de la dictature roumaine, encore moins de la révolution qui la fait s’effondrer, laquelle est rapidement évoquée par des images d’archives à la toute fin, avec un lien entre les récits fictifs et le récit historique drôlement invraisemblable. Quoique réaliste en même temps : pour le voir, il faut rester jusqu’à la toute dernière minute des deux heures et dix-huit minutes du film pour ne pas manquer la dernière image du générique…