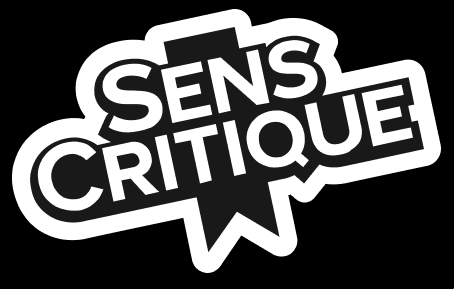Il y a un peu plus d’un an nous quittait Henri Gougaud, conteur intarissable, jongleur de mots, infatigable eur de mémoire, voyageur de l’imaginaire, pourfendeur de carcans et de certitudes. Il nous reste de lui le souvenir de sa verve pleine de bonhomie, de son authenticité, de sa profonde humanité. Mais son plus précieux héritage, c’est sans conteste ce trésor de mots et de contes souvent puisés aux sources du Moyen Âge occitan qui laisseront pour longtemps gravé en nous le souvenir de personnages, êtres qui semblent faits de chair autant que de papier, qu’il peignait avec acuité et bienveillance.
Ceux qui peuplent son dernier récit ne font pas exception à la règle. Dans cette salle du tribunal d’inquisition de Pamiers où se succèdent hérétiques (mais au fond, il en reste relativement peu, après la sanglante croisade contre les Albigeois), blasphémateurs, vrais lépreux et faux sorciers, tous trouvent grâce à ses yeux, ou plutôt à ceux du narrateur, son double, son frère. Jean Jabaud est l’ancien greffier de Jacques Fournier, évêque cistercien et inquisiteur (la chose n’est pas fréquente) devenu par la suite Sa Sainteté Benoît XII. Le scribe n’est pas homme à juger son prochain. S’il est chrétien, c’est de nom seulement, puisque comme tous en ce XIVe siècle il reçu le baptême. Dire que sa foi est boiteuse est un euphémisme et son scepticisme croît au fur et à mesure de la tâche ingrate qu’il accomplit chaque jour en consignant les minutes des procès où d’infortunés accusés risquent leur vie, qui pour s’obstiner à ref de jurer, qui pour ne pas avoir payé la dîme ou pour s’être amusé d’une plaisanterie jugée blasphématoire. Et ce n’est pas la tâche la plus effroyable qu’il devra accomplir, loin s’en faut.
Pourtant, l’inquisiteur Fournier, même s’il fait preuve d’un zèle intransigeant, est loin d’être le plus sanguinaire de ses confrères et bien que romancé, le portrait qu’en dresse le narrateur rend assez justice à l’évêque de Pamiers, dont on sait qu’il fut relativement modéré dans ses jugements, peu enclin à la torture et plus disposé à vouloir persuader qu’à punir aveuglément. Reste que le jeune scribe est au départ autant révolté que terrorisé par un maître qui semble avoir un don exceptionnel pour discerner le manque de ferveur de son employé. Il culpabilise également d’être, même de loin, un rouage d’une institution sinistre qui broie les corps et fait trembler les âmes, même s’il trouve une consolation dans le fait que ses écrits contribueront au moins à conserver la mémoire des accusés. Pas plus à l’époque qu’aujourd’hui il n’est facile de s’accommoder avec sa conscience lorsqu’on est forcé d’obéir à des ordres iniques.
Les vrais héros, ce sont donc ces malheureux qui, grâce à Jean Jabaud, échappent à l’oubli : hérétiques, libertins, grandes gueules, femmes trop libres ou trop belles, pauvres hères, juifs ou lépreux, désignés comme boucs émissaires. Chacun se défend comme il le peut dans un jeu où certes tout n’est pas joué d’avance mais où les dés sont tout de même bien pipés. Car, nous le comprenons assez vite, c’est bien d’un jeu sinistre qu’il s’agit, chacun des participants étant sommé de jouer son rôle, celui de l’inquisiteur étant de semer la terreur et d’obtenir l’obéissance aveugle au dogme plus encore que de condamner les hérétiques au bûcher. Et ce rôle, il le joue à merveille, même si on perçoit assez vite qu’il y prend moins de satisfaction qu’on pourrait le croire de prime abord.
C’est là tout l’art du conteur, qui au-delà des apparences scrute les âmes, cherche les failles, accompagne chacun dans son cheminement personnel, construit les ponts qui amènent les êtres à se comprendre. C’est ainsi qu’entre le redoutable évêque et son humble greffier se tisseront des liens certes ambigus, mais qui permettront aux protagonistes d’accueillir l’altérité, qu’elle se situe dans autrui ou en eux-mêmes. Petit à petit, l’inquisiteur s’éveille à la beauté d’un monde moins étriqué que celui des règles rigoureuses que par ambition personnelle autant que par conviction, il a choisi de suivre. Tout en sauvegardant les apparences, il sort parfois de son rôle, entrouvrant au age certaines portes de prison. Le narrateur quant à lui découvre que son refus du «Tout-Puissant des sacristies» ne le contraint pas au nihilisme :
(…) le néant auquel je me croyais voué était joliment constructible. J’étais maître chez moi, et ce chez-moi était aussi démesuré que l’univers visible. Je pouvais y loger le Créateur des mondes, s’il me plaisait de l’accueillir
Henri Gougaud s’en est allé discrètement emportant avec lui cette générosité et cette simplicité de cœur qui le caractérisaient. Il nous lègue avec ce dernier récit une leçon pleine de sagesse. J’aime à l’imaginer désormais pèlerin des étoiles en quête d’autres possibles, lui qui affirmait que “Jusqu'à ta mort et même au delà tu devras grandir, grandir encore.” Puisse l’univers foisonnant qu’il nous laisse nous permettre à nous aussi de grandir, de rêver, de nous émerveiller, de nous ouvrir avec plus d’indulgence aux autres et à nous-mêmes.