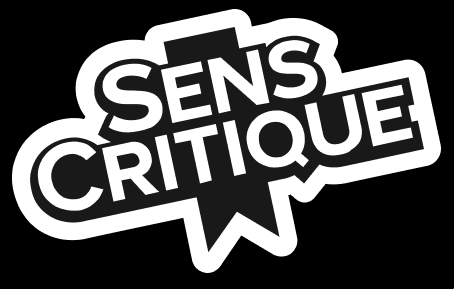Né en 1901 à Farino, en Nouvelle-Calédonie, Mariotti, qui a écrit et vécu l'essentiel de sa vie en , raconte dans ses romans ses souvenirs d'enfance.
Ici, tout se noue autour d'un décalage générationnel. Multitude de personnalités différentes ont fait souche en Nouvelle-Calédonie : déportés du bagne, fonctionnaires en service à l'autre bout du monde, colons libres idéalistes, saint-simoniens par exemple, ou trompés par la propagande coloniale ; et des Indiens et des Chinois venus y travailler. Et voilà leurs enfants, qui n'ont connu rien d'autre que la brousse. Avant les travaux de l'armée américaine et australienne en 1942, l'île n'avait presque pas de routes, presque pas de ponts. On vivait dans la béance de la brousse verdoyante - même Nouméa aujourd'hui est envahie par la végétation tenace des tropiques -, on vivait dans l'isolement, la solitude, l'errance aussi. La terre est mauvaise ; se fixer est difficile, alors on cultive par-ici et puis par-là, sans s'attacher, sans parler des hordes de misérables qui hantent les routes et pratiquent à l'occasion le brigandage.
Pour ces gosses, la brousse, la nature, c'est tout : toute leur vie. Ils l'aiment, imaginent difficilement autre chose. Tel n'est pas le cas des adultes. Les grandes personnes tiennent en horreur cette nature sauvage, où l'on ne comprend rien. Les arbres sont nommés maladroitement en référence aux arbres connus : faux acacia, faux poivrier, faux lilas, faux tabac... En brousse, "il y a rien" : c'est ainsi qu'on l'exprimait. La "Petite des campagnes", ainsi qu'elle devait devenir, ne donna rien, les techniques agricoles européennes n'y ayant causé que misère et famine. L'institutrice le dit bien : il n'y a pas de vraies saisons en Nouvelle-Calédonie ; "Quand, dans l'année, fait-il le plus chaud ?" demande-t-elle aux gamins. "En décembre et en janvier, quand l'herbe jaunit - Non, c'est en juin et en juillet, quand les champs se couvrent du blond des blés. - Mais en juillet c'est la saison la plus froide, on se couvre... - Ne croyez pas que les saisons ici sont réelles !" Le vrai monde, c'est la , la rêvée, jamais connue, décrite par le menu à l'école. On a une pomme à manger : c'est une relique de cette patrie perdue, on la chérit. Dans les jardins, on cultive des plantes européennes, même si elles ne donnent rien, comme cet amandier qui ne cesse de fleurir sans jamais pouvoir donner de fruit. Un frère et sa sœur décident de planter des plantes de la brousse ; on les tient pour un peu fous. Un jour, un visiteur s'en avise et, ô surprise pour la gamine, il dit : "Tout de même, nous ne connaissons même pas le nom de nos plantes." Nos plantes !
Et les Canaques ? Les enfants ne comprennent pas quand l'institutrice les traitent de Canaques. Pour eux, les Canaques connaissent les secrets des eaux et des forêts. Ils ont pour eux beaucoup de respect, dans leur soif de comprendre ce monde que les adultes rejettent. A-t-on dit que tel fruit de la brousse était bon à manger ? On le croira, même si l'expérience dira le contraire, et on réessayera jusqu'à trouver la façon de le manger correctement, pour qu'il soit bon.
Pour les Canaques aussi le temps fait son œuvre. Depuis la grande insurrection de 1878, ils ont perdu leurs dernières bonnes terres. Les chefs sont traités comme n'importe qui par les Blancs. On rêve de nouvelles insurrections, du retour au temps d'avant, l'âge d'or où l'on était pas humilié par les machines des Blancs, où l'on faisait sans. Et le rêve des flottilles de pirogues voguant dans le lagon est pulvérisé par les canons d'un navire de guerre européen. Quelque chose transforme le monde. Contre la volonté des Canaques. Contre la volonté des colons, contre la volonté de l'istration coloniale elle-même.
Une épave échouée dans le récif, nommée l'Incertaine, captive l'imagination du frère et de la sœur. L'Incertaine, aperçue lorsque, du haut de la Chaîne, le gamin voit la mer des deux côtés de l'île, comme s'il y était, sur l'Incertaine. L'Incertaine, cette île dont l'histoire n'est que soufs, douleurs, violences, pour tous ses habitants, autochtones, déportés et colons.
Un siècle plus tard (l'histoire, réminiscence des souvenirs d'enfance de Mariotti, devait se dérouler vers 1910), moi je me retrouve dans ces gosses, leur amour pour la nature, les rivières, la vie au grand air de la Calédonie que j'ai connu au même âge, comme si rien n'avait changé. Mais les choses changent : peut-être cette étrange expérience de Français dans ce nouveau monde, vide et mystérieux, touche-t-elle à son terme.