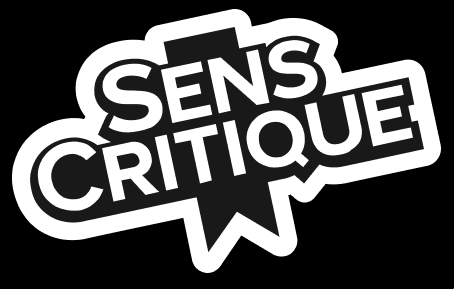Quand Snake Eater est sorti, j’étais déjà converti au culte de Kojima. J’avais grandi entre les murs froids de Shadow Moses et les plateformes métalliques du Big Shell. Alors quand on m’a balancé dans une jungle soviétique, torse nu, avec des serpents à croquer et un radar en option… j’étais paumé. Et conquis.
Snake Eater, c’était un choc. Plus de codec ultra-tech, plus de radar pratique, plus de ration miracle qu’on sort de la poche arrière comme une barre de céréales. Là, fallait chasser, se soigner, observer, s’adapter. Se fondre dans le décor. C’était un jeu de guerre qui te disait : la guerre, c’est sale, ça gratte, ça saigne, et si tu veux survivre, va manger un serpent. Et tu le faisais, parce que c’était crédible. Parce que le gameplay t’y poussait sans jamais forcer.
Et puis il y avait The Boss. Ce personnage. Cette femme. Une mentore, une légende, une trahison vivante. Dans un média encore bourré de clichés masculins, la faire incarner la grandeur, le sacrifice, la dévotion à une mission impossible, c’était grand. Ce twist final, cette larme qui monte quand Snake se voit remettre le titre de “Big Boss” qu’il n’a jamais voulu… Oui, Snake Eater avait quelque chose de tragique. De grec, presque.
Et puis il y avait le contexte : la guerre froide, la crise des missiles, le spectre de la bombe nucléaire, les cicatrices du XXe siècle. Tout ça distillé dans un jeu vidéo. Un jeu, oui. Mais quel jeu. Quand on a connu ça jeune, on comprend vite que Metal Gear ne se contente pas de nous divertir : il nous éduque, il nous bouscule.
Aujourd’hui encore, je fredonne “Snake Eater” dans ma tête en montant un escalier ou en épluchant une patate. C’est dire la trace qu’il a laissée.