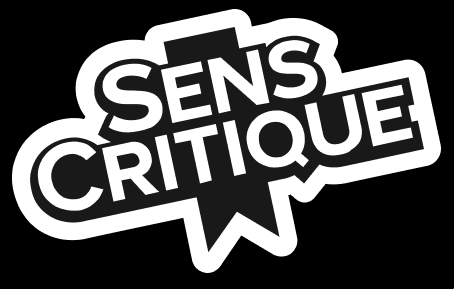Voilà un film que je voulais voir depuis longtemps. Très lent dans sa narration, presque documentaire par moments, “Voyage à Tokyo” m’a touché en plein cœur à de nombreuses reprises grâce à une sobriété folle, un cadrage pictural, mais surtout grâce à la longueur des scènes qui me permet de savourer pleinement les émotions des acteurs.
Le film m’a ému d’un point de vue très personnel. La plupart de mes œuvres préférées abordent le temps qui e, ce temps qui file sans que l’on puisse rien y faire. C’est, à mes yeux, le thème le plus universel qui soit, celui que nous partageons tous, chacun à notre manière. “Voyage à Tokyo” appartient à cette catégorie de films. Il raconte l’histoire d’un vieux couple qui se rend à Tokyo pour rendre visite à ses enfants et petits-enfants. Hélas, tous sont absorbés par leur travail et n’ont jamais vraiment le temps de s’occuper de leurs parents, les laissant terriblement seuls.
Derrière cette histoire en apparence simple se cache en réalité quelque chose de bien plus profond et bouleversant : la mise en scène de Yasujirō Ozu. Jamais, durant les 2 h 16 du film, la réalisation ne porte de jugement moral sur ces enfants que l’on pourrait juger irresponsables. Jamais elle ne les blâme d’avoir construit leur vie loin de leurs parents. Ozu préfère montrer la profonde mélancolie qui habite tous ceux qui arrivent au crépuscule de leur existence. Car au fond, c’est là le message du film : la vie suit son cours. Que les gens vivent ou meurent, la vie continue.
Les plans finaux, avec ce bateau voguant sur la mer intérieure, suivis d’un plan sur des enfants sortant de l’école, dans une même fluidité, disent tout du temps qui e. C’est simple, mais c’est beau. La première réplique du grand-père après la mort de sa femme, “Il y a un beau lever de soleil”, résume tout : la vie continue, le soleil continue de se lever. C’est bouleversant dans sa simplicité.
Au-delà de cela, il faut aussi souligner la manière somptueuse qu’a Ozu de filmer les visages, les conversations les plus banales, et le poids qu’elles portent. Certains diront que c’est trop long, que c’est ennuyeux… À ceux-là, je répondrai qu’ils sont responsables de leur propre ennui. Car il y a tant à voir, à analyser, à irer dans ce film, pour peu que l’on prenne le temps de s’y plonger.
La scène qui m’a le plus touché, à titre personnel, est celle où la grand-mère tente, tant bien que mal, d’échanger avec son jeune petit-fils. Elle lui demande ce qu’il fera plus tard, puis s’interroge elle-même sur l’endroit où elle sera quand ce garçon deviendra adulte. Le visage plein de tendresse et de mélancolie de cette vieille dame m’a rappelé mes propres grands-parents. Le film regorge de scènes similaires où les visages, les dialogues, la façon de les prononcer, nous font traverser une palette d’émotions subtiles, solennelles, alors même qu’il ne s’agit que de moments ordinaires.
Je e rapidement sur le commentaire que fait le film de l’après-guerre au Japon : le mal causé par la guerre, l’américanisation de la société, le travail qui empêche la famille de se réunir, et la ville de Tokyo que Ozu ne filme jamais vraiment, sauf pour en montrer les aspects les plus quelconques ou laids – un choix assumé. Ce commentaire est pertinent et s’inscrit dans la thématique du film, mais je dois avouer qu’il m’a moins intéressé que les personnages et leurs discussions. Sur la question du temps qui transforme une nation, j’ai d’ailleurs préféré “Au-delà des montagnes” de Jia Zhangke, un autre chef-d’œuvre que je vous recommande vivement.
En bref, “Voyage à Tokyo” est un film qui, en dépeignant le banal, atteint au sublime.