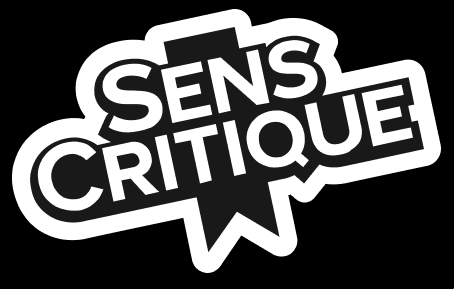En sortant du cinéma pour voir ce film, mon seul regret est d’avoir raté Lumière, l’aventure commence (2017) dont celui-ci est forcément dans la lignée. Ceci dit, le présent volet peut se voir et s’apprécier tout à fait indépendamment. Il présente 120 films des frères Lumière (l’immense majorité étant réalisés par Louis), restaurés (sauf un), que Thierry Frémaux montre selon ce qu’il souhaite en dire, en organisant le tout essentiellement dans un ordre chronologique, de façon à faire sentir le cheminement intellectuel des frères Lumière. Précision importante, depuis le début des années 2000, Thierry Frémaux est en charge de la sélection des films présentés en compétition officielle au festival de Cannes. D’autre part, il préside le festival Lumière à Lyon depuis 2009.
Malgré sa légitimité à présenter les films des frères Lumière, on peut discuter le fait que Thierry Frémaux soit ici considéré comme le réalisateur, puisqu’il n’a quasiment rien tourné de ce qu’il présente. Son rôle serait plutôt celui d’un monteur-présentateur, un rôle cependant primordial, car sans son action, sa volonté (restauration notamment), ces images nous resteraient inaccessibles, ce qui serait bien dommage. A vrai dire peu importe, parce que ce film nous donne la possibilité de voir en salle, donc sur grand écran, des images qu’on ne voit jamais et de nous replonger dans une ambiance assez exaltante. Pour les ionnés de cinéma, comme le dit Frémaux, c’est l’occasion d’en voir les débuts qui n’ont rien d’un balbutiement anodin. Frémaux a bien raison de dire qu’avec le cinématographe des frères Lumière (qui coexistait avec le système mis au point par Edison aux États-Unis), tout est déjà là, avec la mise en scène, le jeu des acteurs, le choix d’un cadre et d’un sujet ainsi qu’une sorte de scénario serré. En effet, le cinématographe à ses débuts permettait de filmer 50 secondes d’un plan fixe. Bien évidemment, l’expérience a donné des idées et la caméra plantée sur un véhicule permet déjà de s’affranchir du plan fixe simple. Ce qu’on voit de personnages sur une sorte de trottoir avançant selon des courbes sur un plan surélevé donne déjà de telles sensations qu’on comprend que le public ait été rapidement fasciné. Alors, si on a plaisir à voir et revoir L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat ainsi que La sortie des usines Lumière à Lyon et L’arroseur arrosé qui ont contribué à la notoriété des frères Lumière, ces 1h45 de projection en présentent bien d’autres qui apportent un panorama de l’importante production de l’époque 1895-1900. Une production qu’on peut bien considérer aujourd’hui comme un véritable trésor. En effet, elle ne se contente pas de montrer les débuts du cinéma (qui s’appelait alors cinématographe), puisqu’elle en fait sentir le potentiel. Surtout, elle constitue un témoignage fabuleux de l’époque, puisque les frères Lumière ont planté leurs caméras face à la vie en mouvement, que ce soit dans les villes ou à la campagne, pour capter ce qu’il y avait d’intéressant à observer, que ce soit dans une scène ou dans des détails. On y voit de nombreux anonymes, parfois très curieux vis-à-vis de la caméra elle-même, ou soucieux de se montrer sous leur meilleur jour (comme ce forgeron en plein travail avec chemise blanche et cravate) ou pour montrer ce qu’ils savent faire (comme cette famille d’acrobates). L’éventail des situations choisies s’avère multiple et significatif.
La restauration est de tout premier ordre et permet de profiter de tout cela dans des conditions remarquables. Thierry Frémaux en profite pour apporter de nombreuses informations intéressantes, qui vont des commentaires sur la vie de la famille Lumière à des considérations techniques en ant par celles de la vie telle que ces petits films nous la présentent. Il va jusqu’à nous montrer Francis Ford Coppola reprenant de nos jours le principe de La sortie des usines Lumière à Lyon où l’on retrouve un visage familier auquel ce film adresse un hommage. Le seul bémol, c’est qu’en ionné, Thierry Frémaux va peut-être un peu trop loin parfois, commentant des scènes qui se suffisent à elles-mêmes (tout en bénéficiant du choix bien adapté de musiques de Gabriel Fauré comme accompagnement) et pour lesquelles sa vision peut laisser entendre qu’elle ne se discute pas. Or, nous savons bien que la force d’une œuvre d’art consiste à ouvrir la porte aux interprétations. Autant dire que le cinéma muet s’y prête très bien.