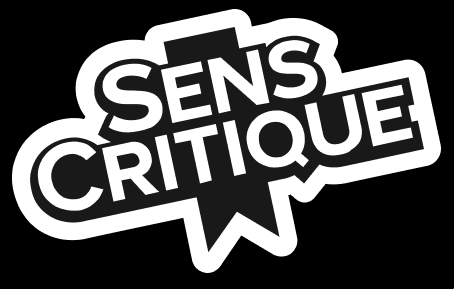J'ai fait les choses à l'envers : vu "L'aventure continue" avant "L'aventure commence", que j'avais raté à sa sortie. L'expérience fut un peu moins forte, du seul fait de la redite. Mais les deux films sont proches dans l'esprit : une grosse centaine de vues Lumière, rassemblées par thème - parfois les mêmes d'un film à l'autre -, dûment commentées par Frémaux.
Dès le début, tout était là, voilà ce qui frappe lorsqu'on découvre ces joyaux restaurés. Les contraintes étaient fortes : pas de rails pour les travelings, pas d'effets spéciaux, et surtout une limite de temps imposée par la taille de la bobine. 50 secondes pour raconter une histoire. Louis Lumière et ses nombreux assistants y développèrent un art du scénario et de la mise en scène qui influença bon nombre de grands cinéastes : Frémaux cite notamment le début de Titanic, copié sur une vue Lumière extraordinaire, montrant un paquebot quittant le port.
Les Lumière, c'est d'abord l'art de la composition. L'influence de la peinture est palpable. Mise en valeur de la ligne de fuite, avec le train entrant en gare de la Ciotat, masse sombre à gauche s'opposant aux voyageurs aux teintes claires, ou avec un défilé étonnant de nourrices poussant leurs landaus. Motifs circulaires, avec ces alpinistes noirs sur la neige, formant un tracé mouvant. Choix d'un sujet central, avec l'obélisque de la place de la Concorde flanquée d'une fontaine abondante, animées par la vie autour que constituent les ants et les fiacres. Découpage en trois plans, avec des lavandières en bas au travail, des hommes observant la scène au milieu, une rue où circulent des fiacres tout en haut (et à la fin de la scène, un seul homme tout en haut). Ou en deux plans, avec la sortie d'un bloc de minerai clair que les mineurs arrosent, à laquelle s'oppose, au-dessus et perpendiculaires, les wagonnets noirs poussés par d'autres ouvriers. Parfois un film célèbre comme L'arroseur arrosé, est réitéré pour cre la profondeur de champ : la comparaison des deux versions est captivante. Comme il le refera dans l'opus suivant, Frémaux met aussi en perspective trois versions du tout premier film, La sortie des usines Lumière, pour constater que deux versions non retenues officiellement comportaient un attelage à cheval.
La place de la caméra, toujours fixe, est un enjeu central, ce qui amena les Lumière à exceller d'emblée dans cet art - car c'est une règle d'or, qu'on retrouve notamment en musique : pour développer un aspect, éliminez tous les autres pour ne travailler que celui-là. En légère contre-plongée, la caméra peut saisir le Sphynx et la pyramide, tout en incorporant les allées et venues de ants - une façon de rassembler en un plan l'histoire et le contemporain en Egypte. Lors d'inondations à Lyon, le positionnement de la caméra est parfait pour en restituer l'ampleur tout en captant la vie autour. Le choix de cette place de la caméra est parfois audacieux, comme dans cette vue de rameurs en très gros plan, ou lorsqu'une petite fille semble agressée par un énorme chat qui surgit dans le cadre.
Quel est le sujet du film ? Voilà la question que pose souvent Frémaux, nous éclairant sur ce point - quand il ne répond pas simplement "sa beauté".... Il est ionnant de voir un personnage secondaire prendre, en quelque sorte, le pouvoir sur le film : ainsi de cet homme en arrière-plan déployant un enthousiasme excessif dans une scène de trampoline, attirant l'oeil ; ou de cet autre fixant à ce point la caméra qu'il finit par provoquer un attroupement autour de lui et faire oublier le décor urbain derrière lui. Lorsqu'elle envahit l'écran, la fumée peut devenir le sujet, comme dans cette vue de travailleurs au sol, observés au second plan par des bourgeois, bientôt masqués par la vapeur.
Mais au-delà de leur intérêt "technique", qui ravira le cinéphile, bon nombre de ces vues dégagent une réelle émotion. Souvent le rire, puisqu'il s'agissait aussi de divertir : ainsi d'un séducteur "mis en sac", d'une course en sac laissant un maladroit derrière moqué par tous, ou d'une bataille chevaux-canards au Mexique remporté par ces derniers. L'émerveillement, comme dans cette vue des jeunes acrobates, dans celle des hommes sautant sur un cheval à un rythme effréné ou dans cette danse aux foulards colorisée. On s'amuse de voir un protagoniste faire vite pour tenir dans les 50 secondes : un gamin distribue à sa jeune sœur et à sa cousine des grains de raisin le plus vite possible, une danseuse tient à montrer tout ce qu'elle sait faire. C'est parfois un dérèglement inattendu qui est touchant, comme dans cette chorégraphie des chasseurs alpins qui soudain s'arrête sans qu'on comprenne pourquoi : la position fixe de la caméra oblige à un hors-champ parfois extrêmement fécond. Une bataille de boules de neiges entre adultes atteint presque la violence d'une scène de genre. Et que dire du visage radieux de cette petite Vietnamienne avançant vers la caméra, dans une vue que Frémaux considère comme "la plus belle de toutes" ?
Parfois les petits films ont une valeur de précieux témoignages, les opérateurs Lumière ne tardant pas à courir le monde. L'un des plus cruels est celui où deux femmes en blanc, une mère et sa fille, distribue des friandises à des enfants exactement comme on donne des graines à des poules. Glaçant. Les nombreuses vues montrant la foule permettent de constater la décadence effroyable de la mode en un peu plus d'un siècle : du costume trois pièces et canotier au sneakers fluos et jean baggy pour les hommes, des élégantes robes et chapeau fleuri au legging et talons compensé pour les femmes - quand ce n'est pas le jean troué.
On retrouvera peu ou prou les mêmes caractéristiques dans la suite proposée quatre ans plus tard par Thierry Frémaux. Le point faible du premier, c'est la musique : que Frémaux ait choisi Camille Saint-Saëns, contemporain des Lumière, est judicieux, mais que n'a-t-il retenu les airs extraordinaires du Carnaval des animaux (dont l'un est d'ailleurs utilisé par le Festival de Cannes), plutôt que ces insipides pièces symphoniques ? Quelques mélodies de Fauré sauront sublimer L'aventure continue, comme notamment celle utilisée pour la bande-annonce. On objectera qu'au moins une telle musique ne dévore pas l'image. Certes.
* * *
Choix judicieux des vues, commentaires pertinents et féconds, restauration d'une qualité impressionnante : une vraie réussite, qui sera confirmée, voire amplifiée quatre ans plus tard.
7,5