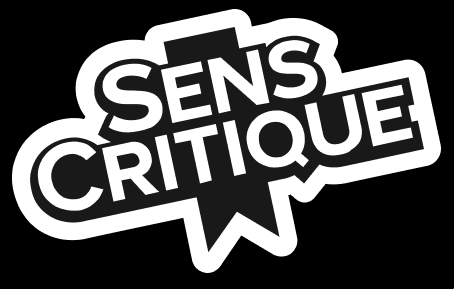Il pleut, et sous la pluie, le monde semble flou mais intensément présent. C’est là que Les Parapluies de Cherbourg trouve sa matière. Pas un film, au fond, mais un état d’âme fixé sur pellicule. Jacques Demy n’expose pas des faits, il propose une idée : celui d’aimer trop tôt, de perdre trop vite, de chanter encore alors que tout s’est déjà tu.
Dès les premiers plans, une caméra aérienne s’abat sur Cherbourg, en aplats colorés, en lignes obliques, en plans géométriques. Le film est entièrement chanté, et c’est cela, le geste fondateur : abolir la parole, abolir la prose, pour ne garder que le vers, le chant.
Ici, la caméra accompagne en plan-séquence, elle danse mais cherche également stabilité : tout est continuum, fluide. Le découpage classique s’effondre dans cette décision radicale d’épo le temps, non pour le contrôler, mais pour le laisser faire son œuvre de corrosion.
Et puis il y a les couleurs. Non pas les couleurs comme effet, mais comme syntaxe. Le rose dragée de l’amour naissant, le vert pétrole des espoirs masculins, le crème mortifère de la résignation bourgeoise. C’est un film-météo, où l’ensoleillement affectif varie à chaque coin de rue. Demy ne filme pas une ville : il filme des émotions qui changent d’habits.
Là où un autre cinéaste aurait tenté l’illusion du naturel, Demy fait le choix inverse. Il assume la frontalité, l’artifice, la pose. Les personnages nous regardent presque, sans jamais briser le cadre. Ce théâtre filmé installe une distance paradoxale : on est à la fois devant la scène et au cœur du drame. Et l'émotion affleure précisément parce qu’elle est cadrée, cadrée comme un souvenir qu’on ne peut pas retoucher.
Et pourtant, dans cet écrin trop parfait, quelque chose vacille. La guerre d’Algérie fissure le vernis. Elle déplace Guy, brise l’axe amoureux, impose au récit une courbure tragique. La gare devient lieu de désamour, d’irrémédiable. Il n’y aura pas de retour, seulement un après trop tardif, trop pâle.
La station-service finale, nue, blanche, froide, agit comme un lieu négatif. C’est l’antithèse de la boutique de parapluies. Là où l’on vendait de la protection fragile, on distribue maintenant du carburant pour continuer à avancer. Guy, en tablier, regarde Geneviève. Il ne chante plus. Ils ne s’aiment plus ou différemment. Tout a été dit, dans les interstices, dans les silences d’un chant qui a cessé.
L’enfant, silencieux, est là. Il ne chante pas, lui aussi. Il regarde, il écoute peut-être. Il est ce qui reste. Une preuve, muette, que quelque chose a eu lieu. L’amour n’a pas duré, mais il a existé.
Alors on comprend : Les Parapluies de Cherbourg n’est pas un mélodrame. C’est une élégie, un chant de deuil en majeur. C’est un film qui croit encore à la beauté du mensonge, à la puissance du faux pour dire le vrai.
Demy filme la perte non comme un fracas, mais comme une pluie continue. Une pluie qui efface les contours, qui dissout les promesses, mais qui, dans sa constance, finit par devenir habitude, c’est peut-être cela, le vrai sujet du film.
Il pleut encore. La dernière note s’éteint. Il ne reste que le silence. Et des couleurs, qui persistent un peu.