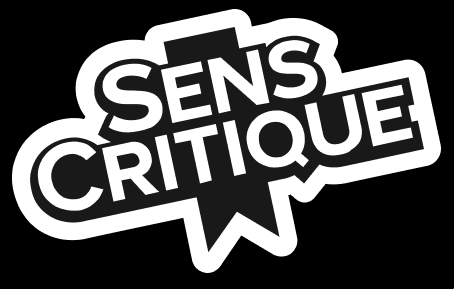La Russie du courrier : une campagne immense où quelques villes inconnues servent de centres de gravité aux villages dont le facteur est un protagoniste essentiel. Formulation d’autant plus adéquate dans le film de Kontchalovski que le facteur est joué par un vrai facteur local (ne pas enlever le F). Le titre d’origine se lit d’ailleurs “Les nuits blanches d’Alexeï Tryapitsine”, ce qui est le nom du personnage ET de l’acteur. Le gars a un film à son nom, au calme, quoi.
C’est le premier signe que le film ne montrera jamais ce qu’il veut garder d’authentique ou construire de neuf. Il est ancré dans le réel de la Russie rurale comme de nombreux films de son époque, & il y a d’un autre côté ce brin de magie simple (vue chez Khudojnazarov) qui transforme le banal en scènes oniriques. Jamais il ne fait de choix ostensible, rendant difficile d’aborder sa symbolique.
Le chat qui apparaît dans les nuits blanches du facteur est-il l’évocation d’un regret, d’une crainte, d’un extérieur qui n’arrive pas à s’imposer ? Est-ce la projection de la peluche de son “neveu”, qu’il oublie le jour de partir à la ville – Arkhangelsk – avec sa mère qui seule mesure la chance qu’ils ont d’aider à l’exode rural ?
Peut-être le chat n’est-il que la manifestation d’un mystère qui manque à cette Russie trop vaste pour embrasser le monde moderne. Le facteur s’imagine le félin pour compenser ce manque, pourtant il est inconscient d’être le mystère de tant d’autres Russes ; il entre sans une once de surprise dans le hangar où l’on construit une fusée – rien de moins – & ne remarquera même pas qu’elle décolle dans l’arrière-plan dans ce qui est pour nous une poétique conclusion.
Désabusé sans le savoir, le facteur dit simplement : “il faut bien transporter les pommes de terre” quand on lui fait remarquer qu’on ne s’envoie plus de lettres ; “on ne va pas tous mourir d’un coup”. Petit coup de pouce au spectateur : de nombreuses scènes sont obliques et/ou animées par des scènes assommantes du quotidien (des choses aussi banales qu’une mouche coincée sur une vitre ou le vrombissement lointain d’un avion), tandis que d’autres, immobiles & droites comme des photos (de magnifiques photos), découpent l’histoire au gré de la vision placide du facteur.
C’est peut-être de là que vient mon conflit intérieur : le sentiment que, derrière la qualité photographique de l’œuvre, il faille adopter un regard complexe sur un propos qui nous hurle qu’il est simple. La composition de l’image ne trompe pas : il faut qu’on se concentre sur l’arrière-plan, sur cette profondeur de champ ouverte, aux thèmes aussi variés qu’il y a de personnages & de paysages. D’accord. Mais l’histoire n’évolue pas dans cet extérieur. Le chat ne devient pas plus éloquent, ni la fusée plus évocatrice. Recyclage d’une idée documentaire ou héritage de la nouvelle poésie cinématographique : il fallait choisir.
→ Quantième Art