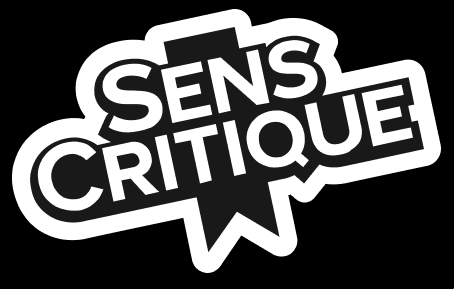**Edgar Wrigh**t est un formaliste. Un vrai. Pas de ceux qui, de façon imbécile, se piqueraient d'une virtuosité vainement tape à l'œil mais plutôt du côté des donneurs de sens, des prestidigitateurs faussement agités du bocal dont les cadres offrent un peu plus que du beau. De la profondeur. Cette geste, le cinéaste l'a exploré, approfondi, enrobé de son obsessionnelle envie de construire un pont idéal entre l'image et la musique, ses deux marottes qu'il investie à coup de nostalgie dépoussiérée.
La première ébauche de Last Night in Soho (initialement intitulé "Red Light Area" puis "The Night Has a Thousand Eyes") fut lancé sur la table en 2007, sans succès. Rebelotte en 2013, un peu avant d'entamer le tournage du Dernier Pub avant la Fin du Monde qui allait boucler sa trilogie Cornetto. Non, il faudra attendre 2017 pour qu' à la surprise générale, le réalisateur décide de laisser provisoirement tomber une suite de son hit Baby Driver. Changement de cap. Toujours amoureux des Swinging Sixties London que ses parents lui avaient décrit en long, en large et en travers, Edgar Wright déménage dans le quartier de Soho puis e Krysty Wilson-Cairns (co-scénariste de 1917 avec Sam Mendes) pour plancher à nouveau sur son projet et envoyer pour de bon la jeune Eloise, apprentie styliste souffrant accessoirement de visions au débotté d'une mère suicidée, dans un trip temporel et sensoriel où elle deviendra une spectatrice du destin tragique de Sandie, chanteuse pleine de rêves, dont les espoirs vont peu à peu s’effondrer sur eux-mêmes et la transformer en prostituée sacrificielle. Hallucinations, schizophrénie et toxicité masculine jusqu’à la moelle, le film nous plonge dans une danse macabre mise en image par Chung Chung-Hoon, directeur photo de Park Chan-wook (entre autres) et accompagné d'une bande son toujours géniale.
En farfouillant une fois encore dans le grenier de la nostalgie à bon compte sans jamais sombrer dans la pure régression, Wright lorgne ici du côté du thriller horrifique et cérébral à la façon du Polanski de Rosemary’s Baby et du Locataire mais envenimé du « giallo » estampillé par les maîtres italiens Mario Bava et Dario Argento. Les hommages se fondent alors dans l'hyper stylisation d'un réalisateur en pleine possession de ses moyens. Subtiles mouvements de caméras, truquages ingénieux, montage inventif, reconstitution soignée (on pense au travail de Tarantino sur Il était une fois à Hollywood), les jeux des couleurs s'amusent à distiller une atmosphère de plus en plus inquiétante et oppressante. Habité par ses deux actrices Eloise/Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit, Old), formidable de candeur borderline et Sandie/Anya Taylor-Joy (Split, Le Jeu de la Dame), le film se contente paradoxalement de seconds rôles erratiques à la symbolique trop appuyée. La présence de Diana Rigg (dont c'est le dernier rôle) et Terence Stamp, avec tout ce qu’ils trimbalent d’iconographie sixties, ou le physique à double tranchant de Matt Smith, exfiltré de Docteur Who, ne rattrapent jamais les archétypes désincarnés (Jocasta/Synnove Karlsen et John/Michael Ajao) qui traversent le film comme des fantômes. Eux aussi. Dès lors, cette absence de moelle qui flirte dangereusement avec les clichés, pose problème en appuyant lourdement sur le cinéma de Wright. Un cinéma qui tournait à plein dans son référentiel à la limite du pastiche (Shaun of the Dead, Hot Fuzz) ou lorsqu'il se transcendait sur le barré Scott Pilgrim (2010) jusqu'à toucher une forme d’acmé dans son exploration visuelle et narrative totalement débridée.
Pour son sixième long métrage, le réalisateur creuse une nouvelle fois le douloureux age à l'âge adulte, convoque des moments d'une classe folle, millimétrés, audacieux et avance en équilibriste au dessus du vide pendant une première heure brillante qui laisse le mystère envelopper le spectateur. Malheureusement, et malgré sa réalisation impressionnante, l'histoire s'effiloche, les enjeux perdent leur singularité et force à l'explicatif. Dans son dernier tiers, le film patine à force de références dégainées jusqu'à plus soif pour contrer ses faiblesses narratives. Edgar Wright abandonne trop rapidement le grain de son histoire au profit d’un magnifique livre d'images en poussant plus loin encore les potards habituels. Last Night in Soho devient alors aussi éblouissant que terriblement frustrant.
Lire d'autres critiques sur mon blog