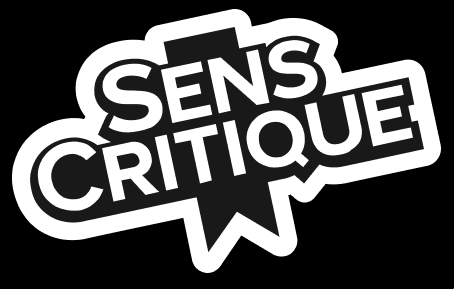Devenue virale en Asie puis en Australie, la tendance TikTok, du before/after qui accompagne "Comment devenir riche (grâce à grand-mère)" et qui à la manière de celle qui avait propulsé "Le consentement" consiste à se filmer joyeux avant le projection, puis ému aux larmes après, interroge dans les deux cas sur la spontanéité (improbable) du phénomène ou tout au moins sur l'origine de la démarche, et surtout sur l'émergence d'un nouveau moyen de promotion des œuvres auprès d'un public très influençable par les "trend" de masse du réseau social chinois.
Evidemment, et même si dans un premier temps, le phénome de massification/d'imitation suffit à créer un mini raz-de marée, la pérennité du succès de l'œuvre dépend pour beaucoup de l'identification des spectateurs cibles aux thématiques du récit et à un personnage particulier, probablement plus qu'à la qualité du film en lui-même. A cet égard, il faut bien reconnaitre que la mécanique du récit, la forme et les ressorts mélodramatiques révèlent une composition habile, posant son cadre et ses enjeux dès la première scène dans un cimetière verdoyant où est réunie une famille pour une cérémonie de célébration des morts... Même si à bien y réfléchir la trame définie dès les premières scènes laisse par la suite peu de place à la surprise ou à l'étonnement.
Les plus jeunes aimantés par ce qui se joue sur l'écran de leurs téléphones, rechignent à disperser les pétales, la matriarche Amah, s'agace avant de faire un malaise qui révélera une maladie bien plus grave, et la proximité de la fin de vie.
Mais alors que le récit initie sa trame (le petit fils streamer- glandeur, décide suivant l'exemple d'une de ses cousines d'accompagner sa grand-mère dans ses dernières semaines afin de devenir l'héritier numéro un), le malaise s'installe, d'autant que déjà l'enchainement des événements ne préserve plus aucun mystère et l'idée que ce pitch de départ, symbole tout de même d'une société un peu malade puisse s'épanouir dans une forme de rédemption provoque une réaction un peu urticante.
Certes, la relation d'abord heurtée, puis un peu plus apaisée entre Amath et M donne lieu dans un premier mouvement à quelques séquences de comédie sympathiques. La grand-mère, dragon acariâtre devient plus touchante et inspire même une profonde affection lorsque l'on comprend que son tempérament rugueux est inspiré par les manœuvres douteuses et intéressées de tous ses descendants, mais la sensation déjà profonde de gêne se décuple lorsque le récit tente une recomposition des relations ées entre la veille dame et un petit fils qu'elle chérissait lorsqu'il était enfant, Boonitipat avouant :
Il est courant que les grands-mères s’occupent de leurs petits-enfants pendant que les parents travaillent, explique-t-il dans un communiqué. Les gamins ent donc une grande partie de leur enfance avec leur grand-mère. Ce lien, tissé depuis le plus jeune âge, devient extrêmement fort. Plus tard dans la vie, il réveille de nombreux souvenirs. C’est quelque chose que je trouve particulièrement touchant .
Le cheminement vers la dramaturgie finale, s'inscrit dans l'attendu, la quête tardive de rédemption de M, son retour à une humanité désintéressée prend des allures éphémères et c'est sans sympathie que l'on quitte le métrage et ce petit fils toujours désobligeant,
malgré son repentir larmoyant